GYNÉCOLOGIE ET SANTÉ DES FEMMES
|
L'OFFRE DE SOINS - PRISE EN CHARGE DES FEMMES
|
![]()
L'analyse des informations issues de bases de données disponibles en France sur l'activité médicale permet d'estimer la répartition des consultations des femmes pour chaque état de santé et d'identifier les activités principales exercées par les deuxprincipaux acteurs de la santé de la femme: le médecin généraliste et le gynécologue.
L'ESSENTIEL* Le nombre moyen de consultations pour motif gynécologique chez le MG est de 3,6 par femme et par an. Ce chiffre croît avec l'âge de la patiente.* Alors que certains états de santé sont pris en charge indifféremment par les deux acteurs (MG et gynécologue) la grossesse et la stérilité restent du domaine quasi exclusif du gynécologue.* Si la majorité des actes en gynécologie sont réalisés par les gynécologues, la part prise en charge par le MG reste notable, elle concerne essentiellement la contraception et la ménopause. |
L'observatoire Thalès analyse exclusivement l'activité des médecins généralistes exerçant en ville. L'EPPM (étude permanente de la prescription médicale) recueille des informations provenant de spécialistes et généralistes exerçant en pratique libérale.
L'observatoire Thalès [18], qui recueille des informations auprès
de 620 médecins généralistes libéraux
informatisés, a permis d'étudier la prise en charge
gynécologique de la femme par le médecin généraliste
en évaluant le nombre d'actes gynécologiques qu'ils ont
effectués.
Le principe de fonctionnement de cet observatoire est de permettre le suivi
d'un dossier patient pendant une période déterminée.
Ainsi, sur la période juillet 1998-juillet 1999, a été
isolé l'ensemble des patientes suivies en médecine
générale pour les états de santé suivants:
– contraception,
– suivi de la grossesse,
– ménopause,
– conséquences de la ménopause (ostéoporose, angor,
HTA, dépression),
– affections bénignes du sein,
– cancers (sein, col de l'utérus, endomètre, ovaire,
côlon, poumon),
– MST (vulvovaginite et salpingite, VIH),
– stérilité.
Pour l'ensemble de ces patientes, les données suivantes ont été obtenues: répartition par tranches d'âge (figure 12) et fréquence annuelle de consultations (tableau 7). Pour chaque état de santé, le nombre d'actes gynécologiques effectués par le médecin généraliste a été calculé. Une extrapolation à la population totale féminine française a été ensuite réalisée afin de déterminer la distribution des actes gynécologiques réalisés en médecine générale.
L'âge moyen des femmes suivies par le généraliste pour motif gynécologique est de 44,1 ans.
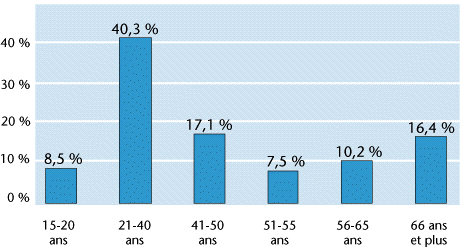
|
Figure 12
|
La fréquence annuelle de consultations chez le médecin généraliste diffère selon les classes d'âge retenues, et croît de 2,5 à 5,5 avec l'âge des patientes.
Tableau 7
|
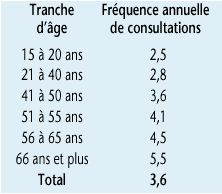
|
Le nombre moyen de consultations chez le MG pour des états de santé en rapport avec la sphère gynécologique (y compris les conséquences de la ménopause) est de 3,6 par femme et par an. Ce sont les femmes le plus âgées qui détiennent le record de la fréquence annuelle de consultations chez le MG pour ces états de santé.
L'extrapolation a permis d'estimer le nombre d'actes gynécologiques réalisés en médecine générale pour les thèmes retenus. Il serait annuellement de près de 3 800 000 (tableau 8).

|
Tableau 8
|
Plus du tiers de ces actes est lié à la prise en charge de la contraception, plus de 20% à celle de la ménopause et plus de 18% au suivi de la grossesse. Ainsi, plus de 75% des actes de médecine générale sont réalisés pour les états de santé "physiologiques" de la femme: contraception, grossesse, ménopause.
La base de données Thalès permet également d'appréhender la proportion d'envois chez le spécialiste pour avis ou prise en charge pendant la durée de l'étude. Un avis spécialisé a été demandé dans 17,6% des cas (dont 6% pour la contraception, 11,2% pour la ménopause et 19,5% pour les cancers). Toutefois cette donnée est à considérer avec réserve, l'outil Thalès se prêtant mal à cette analyse. En effet, l'envoi chez le spécialiste n'est pas toujours lié au motif principal de consultation et les médecins du panel ne saisissent pas systématiquement cette donnée.
Il existe en France une autre base de données qui recueille des informations provenant de médecins généralistes et de spécialistes: c'est le panel EPPM (étude permanente de la prescription médicale, anciennement DOREMA) [10]. Chaque trimestre, un panel différent de 835 médecins généralistes et spécialistes (400 MG et 435 spécialistes, dont 62 gynécologues), exerçant en médecine de ville, transmet le détail des consultations qu'ils ont effectuées. Des extrapolations sont ensuite réalisées pour une année entière et l'ensemble des médecins.
À la différence de l'observatoire Thalès qui tient compte des "dossiers patients", le principe de fonctionnement de ce panel est de s'attacher au motif de la consultation. Le tableau 9 indique le type de praticiens (médecins généralistes ou gynécologues) consulté pour les différents états de santé.
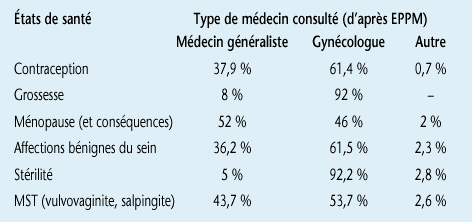
|
Tableau 9
|
Les femmes qui consultent pour grossesse ou stérilité s'adressent préférentiellement au gynécologue. Les consultations pour contraception sont dans deux tiers des cas effectuées par le généraliste qui assure probablement plus souvent un suivi que l'initiation du traitement réalisée, elle, par le gynécologue. Médecins généralistes et gynécologues sont indifféremment consultés pour la prise en charge de la ménopause ou ses conséquences. Toutefois, pour cet état de santé, il est difficile de faire la part entre les consultations pour traitement hormonal substitutif, traitement local ou prévention et traitement des complications de la ménopause telles que l'ostéoporose ou les affections cardio-vasculaires.
L'analyse conjointe des données EPPM et Thalès [10,18] a permis
de déterminer la répartition des actes effectués d'une
part par le médecin généraliste et d'autre part par
le gynécologue (tableau10).
Bien que les deux bases de données étudiées utilisent
des méthodologies différentes (analyse des motifs de consultation
et étude de "dossiers patients"), les informations recueillies concernant
l'activité des médecins généralistes sont comparables
et donc reflètent vraisemblablement la réalité.
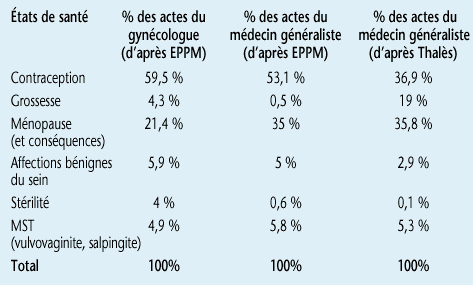
|
Tableau 10
|
La seule divergence retrouvée concerne la prise en charge de la grossesse (0,5% dans la base EPPM et 19% dans la base Thalès). La surestimation de ces actes par la base Thalès pourrait être liée au fait qu'elle ait pris en compte des actes effectués chez des femmes enceintes qui consultaient pour des raisons autres que la grossesse. L'estimation fournie par la base EPPM (0,5%) est probablement plus proche de la réalité. À l'inverse, la base EPPM pourrait sous-estimer le nombre d'actes liés à la grossesse dispensés par le gynécologue par le fait que l'item retenu est la surveillance normale de la grossesse, ce qui exclut un certain nombre de consultations.
Contraception et ménopause, deux états de santé "physiologiques", représentent plus de 80% des actes effectués par le gynécologue et des actes gynécologiques dispensés par le médecin généraliste selon la base EPPM.
Selon l'enquête SOFRES, Regard sur la gynécologie, à laquelle ont répondu 1 633 patientes dont 88% âgées de 45 à 60 ans, les trois principaux motifs de consultation des patientes en gynécologie sont la contraception (33% des femmes interrogées), la grossesse (24%) et la ménopause (22%) [30].
![]()
| La version sur papier de
cet ouvrage a été réalisée par : Editorial Assistance - 18, rue Camille-Desmoulins - 92300 Levallois-Perret - Tél. : 01 41 34 02 60 © 2000, Jean Cohen, Patrick Madelenat, Rachel Levy-Toledano - ISBN 2-86911-958-5 Diffusion : Eska - 12, rue du 4-septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 00 - Fax : 01 42 60 45 35 Diffusion sur l'internet : CNGOF (Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français) (30 mai 2000) |